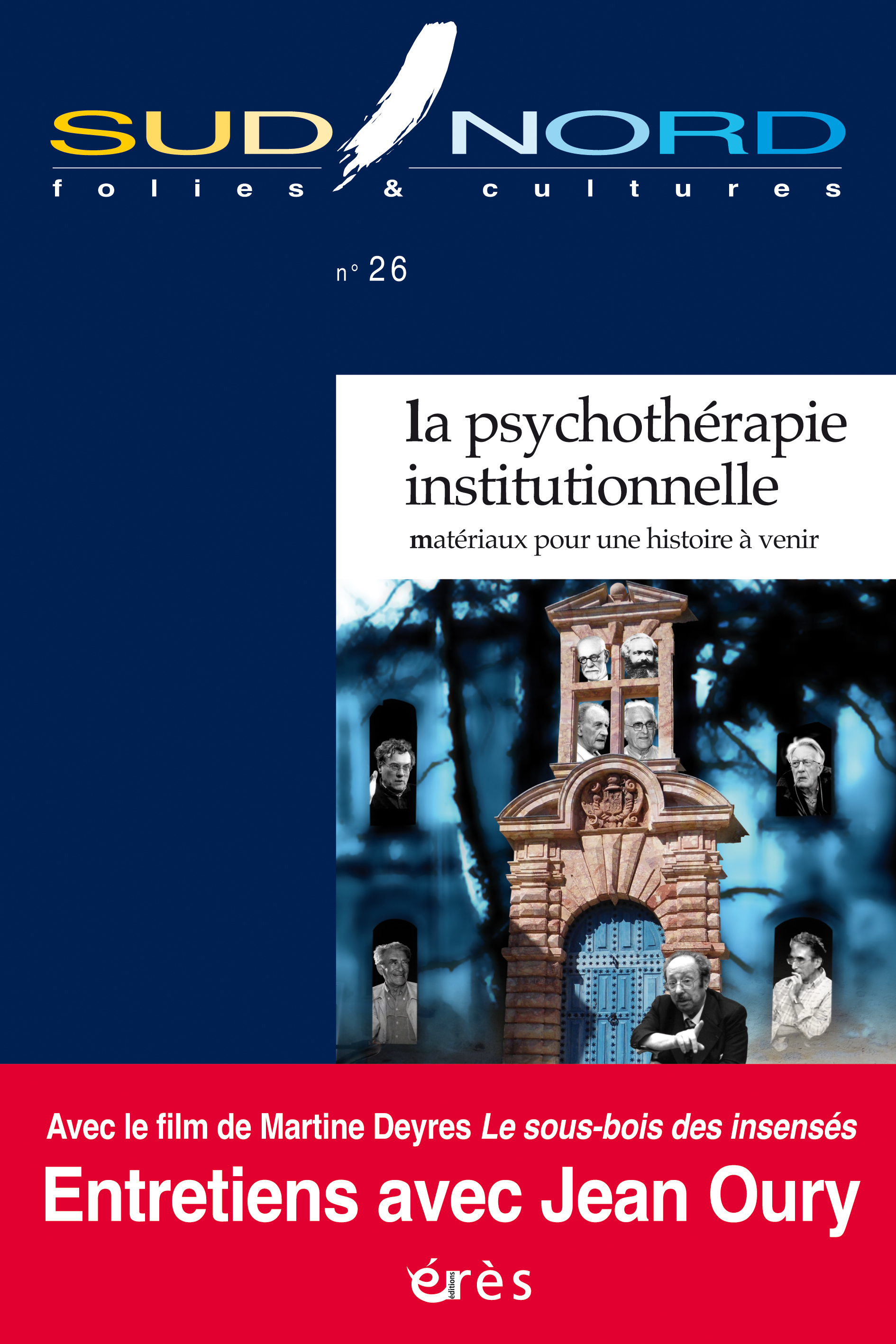Les faire parler ensemble, toutes ces langues, est-ce possible? Possibilité rêvée à la tour de Babel. Dans la pièce de Wajdi Mouawad, "Tous des oiseaux", actuellement représentée au théâtre de la Colline à Paris, il s'agit plutôt que soient toutes présentes les langues des pays en question, Israel, la Palestine, les USA, l'Allemagne; langues de leurs habitants, parfois exilés de leur propre langue, nourris de langues hébergées et transformées en eux, langues maternelles incertaines, langues adoptives, langues de l'ennemi... Langues mouvantes aussi au fil des générations, de leurs engagements, de leurs silences. Et aussi paroles gelées à dégeler, "novlangues", comme Georges Orwell les avait débusquées dans son livre "1984". Et dans cet enchevêtrement des langues, le français est la langue de la traduction qui s'affiche en fond de scène.
Les faire parler ensemble, toutes ces langues, est-ce possible? Possibilité rêvée à la tour de Babel. Dans la pièce de Wajdi Mouawad, "Tous des oiseaux", actuellement représentée au théâtre de la Colline à Paris, il s'agit plutôt que soient toutes présentes les langues des pays en question, Israel, la Palestine, les USA, l'Allemagne; langues de leurs habitants, parfois exilés de leur propre langue, nourris de langues hébergées et transformées en eux, langues maternelles incertaines, langues adoptives, langues de l'ennemi... Langues mouvantes aussi au fil des générations, de leurs engagements, de leurs silences. Et aussi paroles gelées à dégeler, "novlangues", comme Georges Orwell les avait débusquées dans son livre "1984". Et dans cet enchevêtrement des langues, le français est la langue de la traduction qui s'affiche en fond de scène.Par trois fois, la question est posée à l'un des personnages, David, celui qui incarne la deuxième génération de la famille juive dont on conte l'histoire: "Quelle est sa/ta langue maternelle?" Par trois fois la réponse sera démultipliée, contradictoire, donnée par d'autres que lui, chacune recouvrant l'autre dans une fulgurance terrifiante, à l'image des fulgurances des terreurs de la guerre. Ici, même la langue maternelle est incertaine, comme si chacun en avait une réponse propre, à la place de "l'intéressé": son grand-père répondra l'hébreu, sa mère l'allemand, son amie, l'arabe, et tous auront presque raison...
Ce trouble dans la langue se rencontre crûment dans l'expérience psychanalytique quand le sujet ayant tourné le dos à sa langue d'origine, consciemment ou non, ou en ayant été coupé par ceux qui l'ont élevé, se trouve sollicité inconsciemment à y revenir, à se la réapproprier, alors qu'elle se pare des oripeaux de tout ce à quoi il voudrait ou voulait échapper. Langue "mal accueillie" par le sujet quand elle insiste pour se faire une place, au sens où le psychanalyste hongrois Sandor Ferenczi parle de "L'enfant mal accueilli et sa pulsion de mort", titre d'un de ses articles (dans Psychanalyse IV chez Payot pour la traduction française).
Le titre "Tous des oiseaux" est venu faire résonner en moi celui d'une exposition présentée au printemps dernier au Macval de Vitry, "Tous des sangs mêlés". J'y avais trouvé notamment ce tableau de l'Algérie présenté par Karim Ghelloussi dans lequel la France était "occupée" par le drapeau de l' Algérie...
Tableau suscitant de multiples associations et qui est venu rejoindre une recherche que j'ai entreprise sur nos géographies psychiques intimes, en écho aux géographies politiques et aux cartographies de propagande. Géographies mouvantes, elles aussi, notamment au niveau des frontières...
La confrontation des langues, leur nomadisme qui provoque parfois des rencontres explosives, créent aussi des géographies troublées, des frontières méconnaissables, des paysages difficiles à imaginer, des espaces insaisissables. Tous des sangs et des terres mêlés. Toutes des langues nomades: chacun emmène les siennes avec lui, parfois sans le savoir. Elles se rencontrent, s'excluent, se remplacent, se traduisent, s'oublient et s'entendent. Des générations de langues en voyage, en exil, en traduction, en transit, en suspens.
Ce parcours avec les générations de la pièce de Mouawad m'a rappelé aussi celui du regretté Adel Hakim, "Des roses et du jasmin", pièce présentée début 2017 aux Quartiers d'Ivry et créée en 2015 à Jérusalem puis à Ramallah par le théâtre national palestinien de Jerusalem. Drame sur trois générations entre palestiniens et juifs parfois ennemis, parfois amants et aux accents de tragédie grecque... Adel Hakim fait référence, dans la présentation de la pièce à celle de Mouawad "Incendies". Belle filiation de créations qui vont chacune un peu plus loin que celles qui précèdent!
Tableau suscitant de multiples associations et qui est venu rejoindre une recherche que j'ai entreprise sur nos géographies psychiques intimes, en écho aux géographies politiques et aux cartographies de propagande. Géographies mouvantes, elles aussi, notamment au niveau des frontières...
La confrontation des langues, leur nomadisme qui provoque parfois des rencontres explosives, créent aussi des géographies troublées, des frontières méconnaissables, des paysages difficiles à imaginer, des espaces insaisissables. Tous des sangs et des terres mêlés. Toutes des langues nomades: chacun emmène les siennes avec lui, parfois sans le savoir. Elles se rencontrent, s'excluent, se remplacent, se traduisent, s'oublient et s'entendent. Des générations de langues en voyage, en exil, en traduction, en transit, en suspens.
Ce parcours avec les générations de la pièce de Mouawad m'a rappelé aussi celui du regretté Adel Hakim, "Des roses et du jasmin", pièce présentée début 2017 aux Quartiers d'Ivry et créée en 2015 à Jérusalem puis à Ramallah par le théâtre national palestinien de Jerusalem. Drame sur trois générations entre palestiniens et juifs parfois ennemis, parfois amants et aux accents de tragédie grecque... Adel Hakim fait référence, dans la présentation de la pièce à celle de Mouawad "Incendies". Belle filiation de créations qui vont chacune un peu plus loin que celles qui précèdent!
Dans le roman d'Alice Zeniter "L'art de perdre", le personnage de la deuxième génération, Hamid, fils de "Harki", se trouve devoir lire et traduire pour ses parents un texte administratif écrit en deux langues qui se font face ou plutôt qui se tournent le dos. L'image saisie par la romancière est édifiante quand elle évoque les parents d'Hamid: "Les documents qu'on leur a envoyés sont en deux langues, arabe et français, chacune courant vers la marge opposée, et elles s'ignorent superbement, enfermées dans leurs systèmes d'écrire le monde qui ne se ressemblent en rien." (p.314) Là, pas de trouble sur la page, contrairement aux espaces psychiques des langues: une volonté de clarté, deux colonnes et c'est tout.
Il en va bien autrement dans les esprits, dans les relations instaurées par l'impossibilité de lire, de comprendre ou de parler la langue de ceux dont on est pourtant issu, et aussi par les positions disparates des membres d'une même famille au fil des générations, chacun ayant hérité non pas seulement d'une ou de plusieurs langues maternelles mais aussi d'une politique de la langue, de politiques de la langue dans les pays d'origine, dans les pays d'adoption, dans les pays d'exil. Et c'est ce dont nous parlent Wajdi Mouawad et son équipe, d'une façon incroyablement intelligente et émouvante à la fois. Un travail d'une grande portée politique aussi.